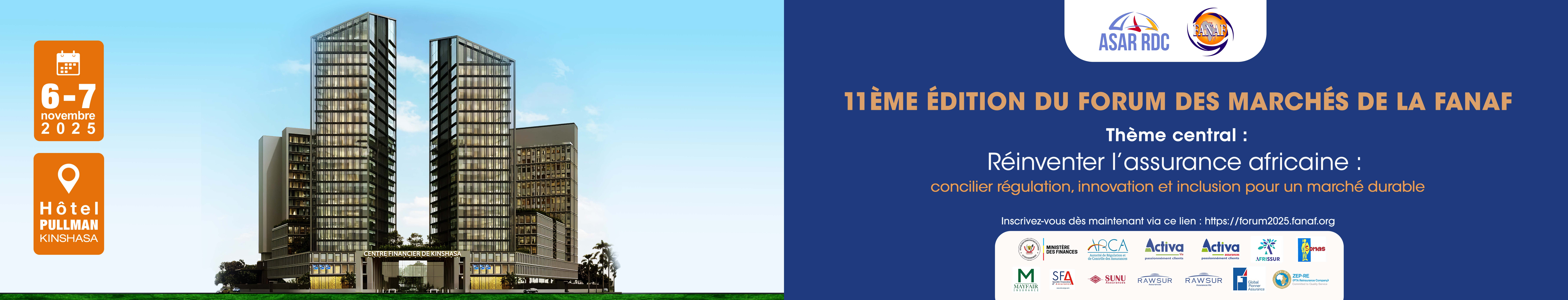Une paix de façade organisée par les complices du désastre
Le 30 octobre 2025, la France organise à Paris, conjointement avec le Togo, une « Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs ».
Sous couvert de dialogue et d’humanisme, cette initiative se veut une réponse à la crise humanitaire à l’Est du Congo.
Mais il faut appeler les choses par leur nom : il s’agit d’une opération de communication politique, destinée à masquer la duplicité d’une diplomatie française profondément compromise dans la crise congolaise.
Depuis plus de deux décennies, la France n’a jamais eu le courage de condamner ouvertement les crimes du Rwanda ni le soutien militaire qu’il apporte aux rebelles du M23, responsables d’atrocités massives contre les civils congolais.
Derrière les discours policés, Paris couvre Kigali. Et derrière les promesses d’aide humanitaire, se cache une stratégie d’intérêts économiques et miniers.
Les minerais du sang : quand Paris et Bruxelles ferment les yeux
Alors que la France prétend promouvoir la paix, elle soutient, via l’Union européenne, des accords miniers avec le Rwanda pour l’approvisionnement en cobalt, coltan et autres minerais dits « stratégiques ».
Une évidence s’impose pourtant : le Rwanda ne produit pas ces minerais.
Ils sont arrachés au sous-sol congolais, dans les zones dévastées par les guerres que ce même Rwanda entretient à l’Est du Congo.
Ainsi, le Rwanda joue le rôle de receleur, pendant que les multinationales européennes — souvent appuyées par la diplomatie française — profitent du chaos congolais pour s’assurer des circuits d’approvisionnement bon marché.
Parler de « conférence pour la paix » dans ces conditions relève de l’indécence : on ne peut être juge et partie d’un drame dont on tire profit.
Francophonie : de la solidarité culturelle à l’instrument d’influence
Le silence assourdissant de la Francophonie face à la tragédie congolaise est révélateur.
Depuis que Paris a soutenu l’entrée du Rwanda dans la Francophonie — un pays qui a pourtant basculé vers l’anglais — et favorisé la nomination d’une ancienne ministre rwandaise à sa tête, cette organisation a perdu toute légitimité morale.
La Francophonie est devenue un outil d’influence politique, servant davantage les intérêts géopolitiques français que la défense des peuples francophones.
Pendant que le sang congolais continue de couler, aucune condamnation claire n’a jamais été formulée contre le Rwanda, pourtant reconnu par l’ONU comme soutenant activement des groupes armés responsables de crimes de guerre.
Macron et la politique du double langage
Le président Emmanuel Macron n’a cessé de tenir un discours ambigu. Devant Kinshasa, il parle de paix et de respect mutuel ; devant Kigali, il ménage Paul Kagame au nom d’une soi-disant « stabilité régionale ».
Cette posture d’équilibriste n’est rien d’autre qu’un calcul diplomatique cynique, qui place la victime et l’agresseur sur le même pied d’égalité.
Pendant que les villes de Rutshuru, Bunagana et Masisi restent sous occupation du M23, la France s’abstient de condamner Kigali.
Le silence de Paris devient alors une forme de complicité tacite, une caution donnée à la guerre par procuration que le Rwanda mène au Congo.
Le Congo doit refuser l’humiliation diplomatique
Dans ce contexte, la présence du président Félix Tshisekedi à Paris serait une erreur politique majeure.
Accepter de participer à cette conférence reviendrait à cautionner un théâtre diplomatique où le Congo est invité à discuter de sa propre souffrance avec ceux qui la minimisent.
La RDC doit poser des conditions claires avant tout engagement :
Le retrait immédiat des troupes rwandaises et du M23 du territoire congolais ;
La condamnation explicite du Rwanda comme agresseur ;
La reconnaissance officielle du génocide congolais par la France et la communauté internationale ;
La mise en place d’un tribunal spécial pour juger les crimes commis à l’Est du Congo, conformément aux recommandations du Rapport Mapping des Nations Unies.
Sans ces gestes concrets, toute discussion sur la « paix » n’est qu’une illusion diplomatique.
Reconnaître le génocide congolais : un impératif moral
Depuis 1996, plus de six millions de Congolais ont perdu la vie dans des violences liées aux guerres d’agression et aux pillages de ressources orchestrés depuis Kigali.
Ces crimes, documentés et qualifiés de possibles actes de génocide par le Rapport Mapping de l’ONU, appellent à une reconnaissance internationale.
La France, qui a eu le courage de reconnaître sa responsabilité dans le génocide rwandais, doit aujourd’hui reconnaître la réalité du génocide congolais.
Refuser de le faire, c’est perpétuer l’injustice et donner raison à ceux qui pensent que la vie d’un Africain n’a pas la même valeur selon sa géographie ou ses intérêts géopolitiques.
La reconnaissance du génocide congolais par la France serait un acte historique, un geste de vérité et de justice, préalable indispensable à tout dialogue sincère entre Kinshasa et Paris.
Pour une diplomatie de souveraineté et de vérité
Le Congo doit rompre avec la logique de dépendance morale vis-à-vis des anciennes puissances coloniales.
Il est temps d’adopter une diplomatie de souveraineté, fondée sur la vérité, la justice et le partenariat équilibré.
Les États-Unis, par exemple, ont amorcé un dialogue direct avec Kinshasa, dans le cadre d’accords axés sur la sécurité et la valorisation des minerais stratégiques — sans passer par des intermédiaires prédateurs.
Le Congo doit suivre cette voie : celle de la dignité, de la transparence et de l’indépendance diplomatique.
La dignité du Congo n’est pas négociable
Tant que la France n’aura pas nommé l’agresseur, condamné le Rwanda, et reconnu le génocide congolais, elle restera disqualifiée pour parler de paix.
Participer à la conférence de Paris serait un aveu de faiblesse et une trahison envers les millions de victimes.
Le Congo doit dire non.
Non à la duplicité diplomatique. Non à la récupération politique de sa tragédie.
Non à la mise en scène de la paix par ceux qui profitent de la guerre.
La paix véritable ne se construit pas dans les salons de Paris, mais dans la vérité, la justice et la mémoire des victimes.
Éric Kamba
Géostratège et analyste des questions africaines